Cet article a été écrit dans le cadre d’un partenariat avec Ma raison de vivre (chez Pocket Jeunesse).
Conformément à notre Manifeste, on y raconte ce qu’on veut.
*Les prénoms ont été modifiés.
Le roman Ma raison de vivre, écrit par Rebecca Donovan, dépeint notamment la maltraitance d’une adolescente par sa famille, et les conséquences que ces violences ont sur son comportement, sur sa confiance en elle et dans les autres. Se (re)construire en ayant subi des violences répétées n’est pas simple, et peut être encore plus dur quand elles surviennent à un jeune âge, au moment où notre personnalité se construit.
Des dizaines de lectrices ont témoigné sur les violences dont elles ont été victimes lors de leur enfance et leur adolescence ; Justine nous éclaire sur les mécanismes de la maltraitance, ses conséquences et les recours possibles.
La maltraitance et ses formes
Marie a été maltraitée par sa mère de ses 6 à ses 16 ans :
« Cela a commencé dès l’âge de 6 ans, suite au divorce de mes parents, quand je suis allée vivre avec ma mère enceinte de ma petite sœur. J’ai subi des coups (de chaussures, de ceinture, de martinet) et des violences psychologiques : insultes, dénigrement constant, humiliation… Le pire, c’était les moqueries.
À coté de ça, j’étais une enfant modèle : polie, avec des bonnes notes, respectueuse… Elle n’a jamais battu ma sœur par contre, je n’ai jamais su pourquoi. »
Il arrive en effet que les membres d’une même fratrie ne soient pas tous maltraités. Cela a également été le cas pour KuKaï, qui était avec sa soeur jumelle maltraitée par leur mère, tandis que leur frère plus jeune était complètement préservé.
Par ailleurs la maltraitance ne vient pas forcément des parents : Léandre a été maltraitée par sa belle-mère, Justine par sa nourrice, Wendy par sa tante…
Pour Lise, la maltraitance a été graduelle :
« Je ne me souviens plus exactement de l’âge auquel ça a commencé. Je sais juste qu’on était une famille recomposée, nombreuse, et que mes parents étaient épuisés. Mon père n’était pas beaucoup là, et ma mère faisait tout à la maison. J’ai sans doute débarqué au mauvais moment, au mauvais endroit. Et puis je n’étais pas spécialement une enfant facile à vivre, pas très communicative, pas vraiment dans l’affect. Ça a commencé.
D’abord c’était des cris, pour des histoires de pull mal rangé. Au début ce sont les meubles qui ont pris ; si quelque chose n’était pas rangé je rentrais et retrouvais ma chambre entière au milieu de la pièce, les meubles vidés. Et puis c’est devenu physique. Lorsqu’elle était hors d’elle ma mère me tenait les poignets très fort, me secouait et me postillonnait dessus à grosse gouttes.
C’est graduellement devenu de plus en plus violent, tandis que j’étais pré-ado et de plus en plus renfermée sur moi-même. Bientôt ça a pris la forme de claques, et surtout d’insultes. « Connasse », « pétasse ». « Séductrice », même, à l’adolescence. Quand je pleurais, c’était pour attirer la pitié, selon elle. Mon père a fini par s’y mettre, pour réaffirmer son autorité défaillante.
Puisque je venais d’un milieu bourgeois et que je n’avais aucune trace visible sur le corps, personne n’a jamais compris ce qu’il se passait, pourquoi je détestais les vacances, pourquoi je préférais mettre du temps à rentrer chez moi à pied plutôt que de prendre le bus. Je n’avais de toute façon pas d’amie à qui me confier, et même maintenant, quand j’en parle à mes proches, ils ont du mal à accepter l’idée.
Je n’ai moi-même compris que la situation n’était pas normale qu’au lycée, en voyant comment ça se passait chez les autres et en comprenant qu’il y avait un monde sans toute cette violence. »

Alix a elle aussi subi la violence de sa mère, qui s’est également aggravée à l’adolescence :
« Je me rappelle très bien la première fois où ma mère m’a battue (sans parler des fessées ou des gifles). J’étais encore en maternelle, je devais avoir environ 4 ans, et j’avais ramené à la maison un grand bâton que j’avais trouvé dans la forêt. Mais ce bâton, ce jouet, est devenu ma plus grande terreur.
Je devais avoir encore cassé une babiole (je suis maladroite, et ça, ça n’a pas changé), et ma mère m’a punie en me frappant avec. Par la suite elle a innové, changeant régulièrement d’arme (cuillère en bois, ceinture, chaussure, télécommande, du piment frotté sur le visage, etc.), et a de plus en plus utilisé ses poings, ses dents.
J’étais continuellement recouverte de bleus, de bosses ou de griffures, mais personne ne l’a remarqué. Il faut dire que je le dissimulais bien. J’avais à la fois honte de moi et peur pour ma mère, je ne voulais pas me retrouver seule et séparée d’elle.
J’ai fini par trouver ça normal, par m’y habituer, tout en me disant qu’il ne fallait pas que j’en parle. Cette situation a duré pendant longtemps, trop longtemps. Ma mère est devenue de plus en plus violente quand j’ai atteint l’adolescence — physiquement et moralement.
J’étais une « pute », j’étais « moche et nulle », aucun homme ne voudrait de moi… Toutes les parties de mon corps ont été l’objet de ses insultes. Notre relation était extrêmement violente et très dure. Je ne me suis jamais tue, j’ai toujours répondu à ses mots, mais jamais à ses coups.
Forcément mon adolescence a été très difficile : je n’avais aucune confiance en moi, je me détestais physiquement et mentalement, et j’avais peur de rentrer chez moi. »
Qu’entend-t-on par maltraitance ?
L’ODAS (Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée) définit l’enfant maltraité comme « celui qui est victime de violences physiques, de cruauté mentale, d’abus sexuels et/ou de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique ».
Cette définition aborde plusieurs idées. D’abord, elle souligne que la maltraitance peut aller au-delà des coups : elle peut être psychologique (violences verbales, menaces, absence de lien affectif…), ou se caractériser par de la négligence (manque d’attention, absence de soins élémentaires, privation de nourriture, de sommeil). Souvent, une maltraitance accompagne l’autre…
Ensuite, la définition note que la maltraitance ne s’arrête pas lorsque l’enfant ou l’adolescent•e n’est plus avec l’adulte maltraitant : elle a des impacts durables sur le développement des enfants maltraités.
L’association Enfance et Partage précise que la loi du 5 mars 2007 élargit la définition de la maltraitance en ajoutant la notion « d’enfant en danger », qui désigne une situation dans laquelle « la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou risquent de l’être, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».
Pour littlerudy comme pour trop d’enfants, cela a été une violence à la fois physique et psychologique :
« On pense souvent que la maltraitance, c’est les enfants qui ont des ecchymoses, des fractures, qui sont issus de familles en difficultés sociales/financières, etc. Je ne rentre pas dans ces catégories (sauf peut-être pour les galères financières mais qui n’en a pas ?).
Lorsque j’étais petite, je me prenais des claques, surtout des fessées en fait, ou encore des coups de « martinet », quand je n’étais pas sage ou quand je disais quelque chose qui allait à l’encontre de ce que voulaient entendre mes parents.
Je me sentais alors humiliée, rabaissée, et surtout incomprise. Du coup, j’ai toujours eu cette impression constante d’embêter mes géniteurs, d’être un fardeau pour eux… alors que je n’ai jamais demandé à venir au monde !
En grandissant, n’ayant plus l’âge de la claque ou du martinet, c’était les phrases assassines, toxiques à répétition. Du « Dis donc tu as une sale tête ce matin » à « avec ces notes tu vas finir sans métier et à la rue »… »
La maltraitance prend plusieurs formes. Cécile explique par exemple :
« Quand je parle de violence c’était des coups, des privations (de nourriture, interdiction d’aller aux toilettes, etc.), des insultes, des rabaissements — comme « tu feras jamais rien de ta vie », « tu finiras pute », ce genre de choses qui ont du mal à te donner confiance en toi. »

Et c’est d’autant plus difficile à comprendre quand cela vient de l’un de ses parents qui peut malgré tout faire preuve d’affection, comme ce fut le cas pour Élisa :
« Ma mère est morte quand j’étais très jeune et mon père nous a donc élevées seul, ma soeur et moi. Ça a sans doute dû être dur pour lui de se retrouver brutalement parent unique de deux petites filles, mais ça l’a été encore plus pour nous.
J’ai du mal à me souvenir exactement de quand ça a commencé, mais je dirais vers 7-8 ans, peut-être avant. Mon premier souvenir de violence « grave » est celui-là : ma soeur et moi nous partagions un grand bureau en bois que nous maintenions généralement dans une jolie pagaille, avec une sacrée dose d’objets sur le sol en dessous.
Notre père s’est mis en colère et nous a fait ramasser chaque chose une par une, en nous donnant un coup de canne à chaque fois que nous remontions pour les ranger.
Ces épisodes de violences ont été très réguliers jusqu’au milieu de mon adolescence, avec des claques, des fessées, mais aussi des coups de poings et de pieds dans le ventre, des bastonnades à la canne ou à la ceinture. Sans parler des insultes et de la violence psychologique qui va avec.
Entre ces épisodes, il était souvent très affectueux. Malgré cela, je n’ai pas l’impression d’avoir pu apprendre à l’aimer même dans ces moments-là. J’étais toujours dans la crainte, méfiante. Je me protégeais. »
La maltraitance peut aussi être exclusivement psychologique, et est alors difficile à déceler pour l’entourage, comme Rachel en a fait l’expérience :
« Les maltraitances, c’était ma mère. Elles n’étaient jamais physiques, à part quelques baffes (mais ça on y a tou•te•s eu droit), quelque objets balancés au visage. Et le problème avec les maltraitances psychologiques, c’est qu’il est tellement dur de mettre un nom dessus. On n’a jamais envie de s’y reconnaître, d’autant plus qu’on se dit qu’il y a toujours pire ailleurs, et qu’en plus si ça se trouve c’est de notre faute, c’est nous qui sommes des enfants insupportables.
Ça a commencé quand j’avais dix ans à peu près, et ça a duré jusqu’à mes dix-huit ans, plus ou moins, parce qu’après je suis partie de la maison.
Ma mère est dépressive. Elle ne peut se passer ni de ses antidépresseurs, ni de ses somnifères. Elle a eu une vie difficile donc je ne peux pas trop la blâmer. Le problème c’est qu’elle s’est peu à peu isolée de tout le monde, et que j’ai été son défouloir.
Cela consistait essentiellement en des insultes, plus ou moins quotidiennes, et des façons diverses et variées de me rabaisser. Elle me disait très souvent des trucs dans le style « je te déteste, tu es la pire chose qui me soit arrivée » ou encore « je te méprise plus que j’ai jamais méprisé personne dans ma vie », le but étant en général de me faire comprendre que j’étais quelqu’un de profondément mauvais, et que personne ne voudrait jamais de moi.
Parfois ça la prenait d’un coup, pour un incident mineur : elle se mettait à hurler des insanités pendant une bonne demi-heure, et elle se calmait. Elle pouvait aussi passer des jours à m’ignorer totalement.
Extérieurement, c’était insoupçonnable. J’ai toujours donné le change, j’avais des amis, des bonnes notes, et quand j’ai commencé à oser en parler, les gens ont ouvert des yeux ébahis. »
Par ailleurs la culpabilisation vient souvent se mêler à la maltraitance, comme cela a été le cas pour JeunePousse :
« Pendant un moment, je me disais que c’était normal, légitime, que je l’avais mérité à chaque fois, qu’un petit châtiment corporel à but éducatif ne fait de mal à personne, que ça aurait été bénéfique à certains sales gosses d’y goûter de temps en temps ; que c’était une façon comme une autre de punir ses enfants, que ce n’était pas la peine d’en faire tout un plat.
Je me disais que ça ne m’avait pas tuée et que c’était sans doute grâce à ce genre de punition que je n’avais jamais trop embêté mes parents. Mais finalement, je ne le souhaite à personne. »
Et malheureusement, la maltraitance est parfois connue de l’entourage qui ne fait rien… Comme le père de Cécile :
« Dans cette histoire, l’une des choses les plus difficiles est de ne pas comprendre comment mon père a pu cautionner et laisser faire ça pendant des années, car même si ma belle-mère ne me frappait pas en sa présence, il était tout à fait conscient de ce qu’il se passait. »
Il arrive également que l’on ne croit pas l’enfant ou minimise les actes, comme ce fut le cas pour Elopitalsfoutdlacharité :
« Petite j’ai essayé d’en parler, à ma famille, à une assistante sociale. Mais personne n’a jamais rien fait. Ils disaient que ça irait mieux quand je serais grande. Au fond ils ne me croyaient peut-être pas, j’ai toujours eu beaucoup d’imagination… J’ai même fini par oublier que j’avais appelé à l’aide. Comme si ma mémoire était altérée. »
À lire aussi : J’ai été victime de maltraitance psychologique – Témoignage
Une campagne contre la maltraitance visible seulement par les enfants
« Il n’y a pas de petite claque » : stop à la violence éducative
La libération physique
Pour Marie comme pour beaucoup d’autres, la maltraitance s’est arrêtée quand elles ont été assez grandes pour s’y opposer, au moins physiquement :
« La maltraitance s’est arrêtée le jour où ma mère a voulu me battre avec un tuyau de machine à laver. J’avais 16 ans, je savais que j’étais plus grande qu’elle, plus forte et que je n’avais aucune raison de la laisser faire une fois de plus. Je l’ai repoussée, elle a pleuré, puis est allée voir ma grand-mère pour se plaindre du fait que je l’avais frappée.
Je pense que ce jour-là elle a réalisé qu’elle avait abusé ; les violences physiques ont cessé, et les violences psychologiques ont diminué jusqu’à disparaître lorsque je suis partie à la fac à 17 ans. »
Cela ne s’est arrêté pour littlerudy que quand elle a pu fuir le foyer familial :
« Cela s’est arrêté le jour où je suis partie du domicile familial à 20 ans, en somme dès que j’ai pu trouver un logement pour étudiants et fuir ce foyer toxique qui n’était selon les dires de ma génitrice de toute façon « absolument pas chez moi puisque je ne payais rien » ! »

Et pour d’autres comme Rebecca, les violences ne se sont vraiment arrêtées que quand les autorités ont été saisies :
« L’ASE (l’Aide sociale à l’enfance) a été mise au courant de la situation, et m’a placée dans une famille d’accueil jusqu’à mes 18 ans. »
Les conséquences de la maltraitance
Elle a alors pu commencer à se (re)construire :
« J’ai eu une adolescence chaotique où j’ai dû ouvrir les vannes émotionnellement parlant (l’enfant maltraité ne peut écouter ses émotions, il n’a pas ce luxe). Je me suis longtemps mutilée pour « reproduire » ou oublier, et mes cicatrices sont la preuve de tous ces sévices.
Cependant j’ai été éduquée par une merveilleuse famille d’accueil qui m’a bercée d’amour, et j’ai été accompagnée par divers psy qui m’ont aidé à accepter toute cette histoire.
J’en ai hérité une mauvaise estime de moi-même et une forte sensibilité à la culpabilisation : aujourd’hui, il suffit de me dire que quelque chose est de ma faute pour me voir m’effondrer. Mais je travaille dessus et remplis chaque jour ma jauge d’estime de moi en me rendant fière de ce que j’accomplis, et grâce au regard façonnant des autres (notamment de mon amoureux).
Paradoxalement ça m’a permis de développer un mécanisme de défense pour compenser la situation : l’intellectualisation. Comprendre pourquoi les gens font telle ou telle chose est devenu un art de vivre pour moi, car à l’époque il m’a permis de survivre. »
À lire aussi : L’automutilation : témoignage et éclairage psychologique
Le problème de la confiance en soi est récurrent, comme pour littlerudy :
« Étant vulnérable et en « construction » (adolescence), les phrases d’insultes se sont ancrées en moi au fur et à mesure. Tous ces jugements, toutes ces critiques sur chacun des aspects de ma vie ont fini par me faire perdre confiance en moi et mes capacités. »
Élisa est confrontée à des stigmates relativement similaires :
« Une pensée qui me faisait tenir à l’époque des maltraitances, c’était qu’une fois que je vivrais seule, tous mes problèmes disparaîtraient comme par magie. Je serais heureuse.
Malheureusement, ça a été plus difficile que ce que j’imaginais. J’ai découvert que j’avais intégré quelque chose qui me faisait me sentir nulle, triste, et coupable. J’ai eu des périodes de dépression d’intensité moyenne, difficiles à vivre, mais surmontables.
Ce qui me gêne le plus en fait, ce sont ces aspects de mon caractère qui me semblent directement reliés à ces violences : je veux être une femme forte, sûre d’elle, mais j’ai beaucoup de mal à exprimer ce que j’ai sur le coeur. Comme je fuis le conflit, je suis souvent (trop) gentille avec tout le monde, ce qui me conduit très souvent à mettre ce que je désire au second plan.
Dès que j’essaie de verbaliser un conflit avec quelqu’un, mon pouls s’accélère, ma voix tremble… J’ai aussi beaucoup de mal à créer des vraies relations avec mes amis. C’est comme s’il y avait une barrière de verre qui m’isolait des autres… Mais ça, c’est peut-être quelque chose que j’avais en moi dès la naissance ? Je n’en sais rien et je ne le saurai jamais. »
Les conséquences de la maltraitance sont très lourdes. Les brimades qu’Alice a subies ont été extrêmement destructrices :
« J’ai fait une dépression, une tentative de suicide, je suis tombée dans la drogue, l’alcool… Aujourd’hui je commence à me reconstruire, tout doucement, mais je sais que tout cela m’a profondément marquée et je ne suis toujours pas certaine que j’arriverai à travailler suffisamment sur moi-même pour combler toutes ces lacunes que ces neuf années de maltraitance psychologique ont causées.
Je fais de la phobie sociale, ressentant une peur innommable à l’idée d’être jugée, j’ai des tendances à l’anorexie (lorsque je suis angoissée je suis incapable de manger/garder ce que j’ai dans le ventre), des tendances auto-destructrices, une très faible estime de moi-même, je n’arrive pas à m’affirmer face à autrui, je suis très craintive, je ne supporte pas les cris, je perds facilement mes moyens, ne supporte pas qu’une personne ait une forme d’autorité sur moi (ça va des médecins jusqu’aux militaires)… »

Sabrina a pu reprendre le contrôle sur sa vie, mais tout n’est pas facile non plus :
« Le seul point noir reste mes relations sociales : je suis quelqu’un qui parle ouvertement de tout, mais je ne fais pas confiance à grand-monde. Je veux dire, quand on ne peut pas faire confiance à ses parents, à qui on le peut vraiment ? »
Quelles sont les conséquences psychologiques et sociales de la maltraitance ?
La maltraitance, quel que soit son « type », peut avoir des conséquences importantes et durables sur la santé physique, psychique et affective des enfants.
Si la maltraitance laisse des traces visibles sur les corps (lésions, atteintes physiques…), elle peut également être source de « somatisation » : certains enfants maltraités, en-dehors du foyer maltraitant, pourront avoir des malaises, des douleurs abdominales, des troubles sensoriels… Ces troubles peuvent être considérés comme des signaux d’alerte : ils peuvent être une manière pour les enfants d’exprimer, de signaler la maltraitance.
La maltraitance atteint aussi la construction de l’identité de l’enfant. Certains enfants victimes de maltraitance auront des difficultés à avoir confiance en eux, à construire leur identité, à accepter leur image, à s’accorder de la valeur… Comment développer une estime de soi lorsqu’un parent n’assure pas notre intégrité physique et psychologique ? Comment se construire lorsque notre sécurité la plus basique n’est pas assurée ?
Puisque l’un de ses besoins les plus élémentaires (la sécurité) n’est pas assuré, l’enfance des victimes de maltraitance est marquée par un fort sentiment d’angoisse, par une peur et un stress qui suivent l’enfant au-delà de son foyer, et, parfois, par une sensation de désespoir.
Lorsque l’on grandit dans un environnement maltraitant, on est « sous l’emprise » psychologique du parent maltraitant. Certaines victimes de maltraitance pourront ainsi éprouver une culpabilité (« je l’ai mis en colère »), se remettre en question (« il faut que je me comporte autrement »), ou encore aller vers une négation de soi, en s’effaçant toujours plus.
Soyons clairs : la victime, l’enfant, n’est en rien responsable de la maltraitance de son ou de ses parents. Il réalise que quelqu’un, qu’il a parfois appris à aimer, est dangereux et qu’il doit s’en protéger.
À la suite de cette prise de conscience, certain•e•s pourront entrer dans ce que l’on appelle la « décompensation » : toutes les résistances, les défenses tombent, l’équilibre est rompu… Les agressé•e•s « craquent », peuvent subir des états d’anxiété généralisée, manifester des troubles dépressifs, des réponses « physiologiques » peuvent apparaître.
À l’adolescence, les victimes de maltraitance pourront parfois essayer de révéler, de façon directe ou indirecte, ce qu’il leur arrive : par des tentatives de suicides, des fugues, des troubles du comportement alimentaire, des scarifications, des états dépressifs…
Certain•e•s oseront raconter leur histoire pour chercher de l’aide – parmi ceux-là, certain•e•s se rétracteront ensuite, par honte, par culpabilité, par peur des conséquences, par crainte d’aller dans un foyer « pire », par attachement au parent maltraitant… Mais aussi parce que c’est la seule vie que l’enfant connaît : lorsque la « norme » est la maltraitance, comment entrevoir une autre vie ? Comment développer de l’espoir ? Comment faire confiance à quelqu’un qui voudrait nous aider ?
Si la maltraitance menace l’identité de l’enfant, elle menace également sa relation aux autres. Comment se lier aux autres, comment construire des relations sociales lorsque vos relations « de référence » ont été violentes et source de souffrances ? Même à l’âge « adulte », les enfants maltraités gardent des séquelles de la maltraitance – certain•e•s vivront particulièrement isolé•e•s et pourront toujours avoir des difficultés à aller vers les autres, à accorder leur confiance.
Plus tard, l’une des difficultés des victimes de maltraitance sera également de faire le « deuil » du parent qu’ils auraient voulu avoir, « d’accepter », de mettre des mots sur ce qu’ils ont vécu…
En fin de compte, les conséquences de la maltraitance dépendent d’une multitude de facteurs : elles dépendent du traumatisme vécu, des réactions de l’entourage, et les ressources propres de l’enfant. Tous les enfants ne garderont pas les mêmes séquelles, et il n’y a pas une seule manière de grandir dans un environnement maltraitant.
Au-delà des répercussions sur la santé et le bien-être des enfants, la maltraitance a également un impact dévastateur sur la société toute entière : elle a un coût économique, social et psychologique élevé – nous sommes tou•te•s concerné•e•s !
Alix n’a quant à elle pris conscience de ce qu’elle avait vécu que tardivement, mais cette prise de conscience a été salvatrice :
« Quand j’ai eu 20 ans j’ai basculé. Je sortais d’une rupture, qui s’était plutôt bien passée, mais ça a été la goutte d’eau. Je suis rentrée dans une dépression sévère qui m’a obligée à consulter. Je me faisais peur et je savais que je pouvais faire un mauvais choix, un choix définitif.
Les médecins m’ont dit que j’étais sûrement dépressive depuis très longtemps, mais que je m’étais forgé une carapace en béton qui m’avait permis de tenir, jusqu’à ce qu’elle se fissure. J’ai enfin pu parler de ce que j’avais subi et ressenti, et l’on m’a enfin dit que ce n’était pas normal et que non, je ne l’avais jamais mérité. J’ai été en psychothérapie pendant deux ans et j’ai dû prendre des médicaments.
Ma mère a eu un déclic à ce moment-là. Elle a pris conscience de ce qu’elle m’avait fait subir et elle a aussi consulté de son côté. Grâce à cela j’ai pu comprendre qu’elle extériorisait sa propre souffrance et ses peurs, mais surtout qu’elle m’aimait et qu’elle le regrettait. Dans la foulée j’ai déménagé pour m’installer seule mais à côté de chez elle. Depuis je vais bien et nous avons enfin une vraie relation mère-fille, une relation saine, sans coups ni insultes.
Je sais que même si aujourd’hui tout est fini et que j’ai surmonté cette épreuve (je suis diplômée, j’ai un travail et des relations saines avec les autres), je garderai à jamais les cicatrices, physiques et psychologiques, de ces années de douleurs. J’aime à penser que cette situation m’a rendue plus forte et que plus tard en tant que mère j’en tirerai les leçons, en me promettant de ne jamais faire souffrir mes enfants, quoiqu’il arrive. »
À lire aussi : Les TED de la semaine − La dépression
Je suis dépressive — Témoignage
C’est le contraire pour Alizée, qui ressent bien les conséquences de la maltraitance dont elle a été victime, et en a peur :
« J’ai de gros problèmes pour exprimer mes sentiments, surtout les négatifs du type colère, frustration, tristesse… En général je quitte la conversation ou la situation, et je vais juste marcher ou courir. Après coup j’ai parfois eu le temps de mettre les « choses au clair » dans ma tête, et j’arrive à expliquer un minimum ce qui ne va pas, mais pas toujours.
Quand je suis vraiment énervée par quelque chose, il m’arrive aussi d’avoir des accès de colère et j’ai envie de frapper quelque chose. Souvent je me contiens ou je vais faire une séance de sport intense, mais ça m’inquiète et c’est la raison principale pour laquelle je ne veux pas d’enfants. J’ai peur de perdre patience face à eux et de faire une connerie. J’ai abandonné mon rêvé de fonder une grande famille parce que je n’ai pas envie de prendre le risque de devenir comme mon père ou comme ma mère. »
Lise évoque elle aussi des conséquences particulièrement dans ses relations aux autres, mais elle a réussi à les « contrôler » :
« Je ne suis jamais tombée dans la dépression ou l’auto-mutilation. J’ai eu une série de tics, de crises de panique voire certains troubles alimentaires quand sentimentalement ça n’allait pas et que ça me renvoyait à mes échecs passés, augmentant mon impression d’être nulle ou de ne rien valoir. Mais ça n’a jamais été dangereux pour moi ou même vraiment préoccupant.
En fait je suis de nature optimiste, fondamentalement, et surtout passionnée. Par un livre, un auteur, un musicien, un paysage… J’ai appris très tôt à m’évader, sans recours à la drogue ou à l’alcool, ce qui je pense m’a permis de conserver un certain équilibre et de me construire autrement, de façon plus autodidacte et donc parfois plus maladroite.
La principale conséquence qui me reste en travers de la gorge est le fait d’avoir cédé ma virginité face à un homme violent. À l’époque je pensais cette violence normale et je me répétais tout les jours à la maison « Quoique tu dises, quoique tu fasses, ça ne changera rien », pour ne pas trop espérer entre deux crises. Ça n’aide pas vraiment à affirmer sa voix, et en l’occurence son « non ». Une adolescente éduquée dans l’amour et le respect aurait pu avoir la force de se dire « je ne mérite pas ça », mais moi qui pensais mériter mes coups, je ne pouvais pas encore imaginer qu’une autre existence était possible.
Mais aujourd’hui ça va mieux, et c’est la raison de ce témoignage. Avec l’aide, entre autres, d’une psy, j’ai appris à déconstruire ces répétitions favorables à la violence et aux liens insécures, à comprendre pourquoi j’étais attirée par les personnes égocentriques et abusives — les seules, au fond, que je connaissais.
J’apprends à déconnecter ce que je suis de l’image qu’on me renvoie, à me faire confiance et à m’affirmer. J’espère être mère un jour et je n’ai pas du tout peur de reproduire ce même schéma.
Bien sûr j’aurais aimé que tout cela se passe autrement. Mais j’ai arrêté de souhaiter que mes parents changent et j’ai arrêté d’imaginer que cela aurait pu être à cause de moi. Je comprends les parents paumés qu’ils ont pu être, et la façon dont j’ai servi de catalyseur à leurs crises du milieu de vie, une vie plutôt éprouvante.
Ce n’est pas un pardon — pour ça encore faudrait-il qu’ils aient conscience de ce qu’ils ont fait (ce qui n’est pas le cas) — mais c’est la réflexion d’une jeune femme qui ne cherche plus à être la petite fille aimée et protégée par ses parents qu’elle aurait voulu être. J’ai grandi comme ça, autrement, et je suis heureuse aujourd’hui, malgré ça, à cause de ça, peut-être même grâce à ça par certains aspects.
Pour cela j’ai dû arrêter de me penser en victime et devenir actrice, notamment pour cesser de me soumettre face à quiconque élève un peu la voix. J’y travaille encore mais je développe petit à petit ma confiance en moi.
Le plus dur n’est pas d’avoir été battue, mais de continuer à se penser en enfant battu, comme si cette étiquette allait me conditionner pour le reste de ma vie. Cette perspective-là je la refuse, et je sais qu’il est possible de la déconstruire, même si pour cela chacun a sa méthode ! »
Que pouvez-vous faire ?
Si vous subissez de mauvais traitements…
- Rappelez-vous que vous n’êtes pas fautifs de ce qui vous arrive et que vous pouvez trouver de l’aide.
- Si vous êtes mineur•e, tournez-vous vers un adulte en qui vous avez confiance et qui peut vous protéger (proches, parents d’un ami, professeur, médecin, police…).
- Appelez le 119, numéro dédié à l’enfance en danger, gratuit et joignable tous les jours, 24h/24h.
Si vous soupçonnez ou savez qu’une personne est maltraitée…
- Écoutez, croyez et appuyez la personne.
- Si cette personne est mineure, signalez la situation à un organisme d’aide à l’enfance ou à la police.
- Appelez le 119, numéro dédié à l’enfance en danger, gratuit, joignable tous les jours, 24h/24h et qui n’apparaîtra pas sur votre facture téléphonique, où des professionnel•le•s évalueront les risques encourus par les victimes et mobiliseront si besoin les services compétents pour intervenir auprès de la famille.
Pour aller plus loin :
- Le site de l’association Enfance et partage.
- Le site de l’OMS
- Le site de la Haute Autorité de Santé
- Pour en savoir plus sur les démarches à effectuer, consultez le site officiel de l’administration française.
– Retrouvez tous les articles de Justine sur madmoiZelle !
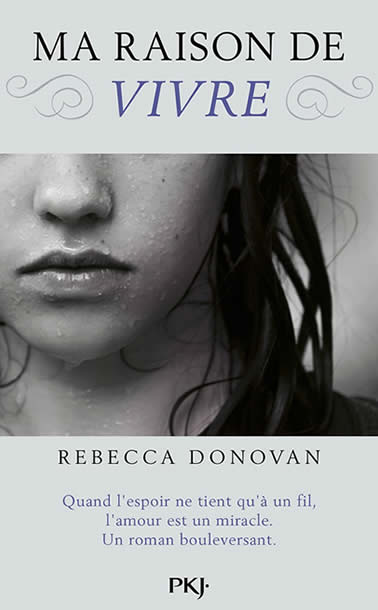
L’héroïne de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan est victime de maltraitance : le roman montre certaines des conséquences de ces violences. Vous pouvez lire un extrait du livre ici.









